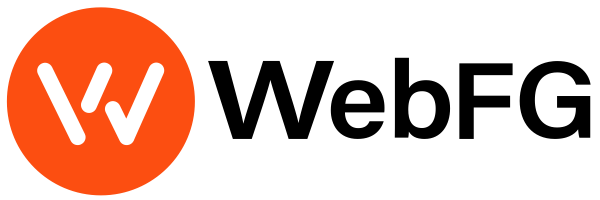News
François Hollande: «Poutine ne connait que les rapports de force»
L'ancien président français pense que Poutine n'acceptera un cessez-le-feu que lorsque les sanctions auront causé des dommages insupportables à l'économie russe.
La guerre en Ukraine fait rage sans relâche. Différents pays tentent de désamorcer le conflit, sans succès jusqu’à présent. L’un d’entre eux, qui a déjà tenté de trouver une solution avec l’Ukraine et la Russie en 2014, est l’ancien président français François Hollande. Avec la chancelière allemande Angela Merkel, il était l’un des artisans des accords de Minsk, qui auraient dû fournir un cessez-le-feu durable et les bases d’un processus de paix – à l’époque pour l’est de l’Ukraine uniquement. Dans cet entretien, Hollande explique comment traiter avec Vladimir Poutine et comment les accords de Minsk pourraient servir de cadre à de nouvelles négociations.
Monsieur le Président, nous assistons à une guerre effroyable en Ukraine, un pays européen. Quelles fautes l’Europe a-t-elle commises pour en arriver là ?
Il n’y a qu’un fautif, c’est Vladimir Poutine. C’est lui qui a déclenché cette guerre, c’est son armée qui bombarde, qui frappe des civils, des théâtres, des hôpitaux. C’est sa propagande qui laisse penser qu’ils seraient les agressés alors que le premier agresseur c’est le président russe. L’Europe, quant à elle, a cru que le commerce, les échanges, le dialogue, pourraient le convaincre de renoncer à reconstituer l’ex union soviétique. Et qu’il ne s’opposerait pas à laisser l’Ukraine rejoindre un jour l’union européenne. Je considère cette attitude comme naïve mais en aucune façon comme fautive.
En 2015, vous avez été l’un des initiateurs des accords de Minsk, afin de trouver une solution au conflit dans l’est de l’Ukraine. Pourquoi cet accord n’avait-il déjà aucune chance à l’époque ?
Si, il avait permis d’imposer un cessez-le-feu et de maintenir le principe de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Pendant 7 ans il a tenu, et a été le cadre dans lequel le dialogue a été poursuivi. Mais il est devenu de plus en plus clair que Vladimir Poutine ne voulait plus garder ce qu’il considérait comme une fiction. En reconnaissant les Républiques séparatistes, il a fait voler en éclats les accords de Minsk mais ils peuvent redevenir le cadre de la future négociation.
Vous avez négocié avec Vladimir Poutine, vous connaissez sa façon de penser. Qu’est-ce qui pourrait aujourd’hui inciter le président russe à cesser les combats et retirer ses troupes ?
Vladimir Poutine ne connait que les rapports de force. Il ira vers un cessez-le-feu et une sortie du conflit que si les sanctions infligent des dommages insupportables à son économie et si la résistance ukrainienne l’arrête, comme c’est le cas aujourd’hui dans son avancée. Alors il cherchera à encaisser son gain, ce qui doit nous conduire à ne pas relâcher la pression, même après la cessation des combats.
La France a tenté sans succès de jouer les médiateurs entre les parties. La France, l’UE, peuvent-elles encore jouer un rôle dans un processus de paix ?
Le format Normandie, né en 2014 et qui comprenait outre la France et l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie demeure une formule possible. Mais Poutine cherche désormais d’autres partenaires : Israël, la Turquie, la Chine. Néanmoins, les Ukrainiens demandent la présence de garants au processus de paix : l’Union européenne peut être l’une des plus crédibles.
A moyen terme, une solution politique entre la Russie et l’Ukraine est inévitable. Quelles concessions l’Ukraine devrait-elle être prête à faire ?
L’Ukraine en a déjà fait beaucoup, en acceptant de ne plus porter sa candidature pour l’adhésion de l’OTAN et en admettant une forme de neutralité. Je rappelle aussi que le Donbass est occupé et que la Crimée a été intégrée à la fédération de Russie. Ce que demande Zelenski, ce sont des assurances pour sa sécurité future et c’est une reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Quelles sont les conséquences de la guerre pour l’Europe en matière de politique de sécurité ? L’Allemagne a annoncé de gros investissements dans son armée. La France doit-elle suivre ?
La France fait déjà un effort important pour la modernisation de son outil de Défense. Elle y consacre plus de 2% de sa richesse nationale. Elle intervient également au Sahel. Par ailleurs, elle dispose d’une force de dissuasion qu’elle entretient pour la rendre crédible. Mais il est important et salutaire que l’Allemagne ai pris conscience des retards qu’elle a pris en matière de défense. Je souhaite que les investissements qu’elle va engager soient coordonnés au sein de l’OTAN avec la France.
L’Europe a-t-elle besoin pour cela de sa propre armée, capable de tenir tête à la Russie. Ou la confiance dans la puissance protectrice des Etats-Unis suffit-elle ?
Avec la guerre en Irak, le lien transatlantique s’est considérablement renforcé et Joe Biden a rappelé l’engagement des Etats-Unis à protéger les membres de l’Alliance atlantique en cas de mise en cause de leur souveraineté territoriale. Mais est-on sûr qu’un jour un autre Président des Etats-Unis aura la même position ? Aussi les européens doivent être capables de se défendre par eux-mêmes et de constituer un pilier solide au sein de l’OTAN.
Quel rôle la Suisse pourrait-elle jouer dans une nouvelle structure de sécurité européenne ?
La Suisse est un pays neutre mais qui consent des efforts importants pour sa sécurité. Elle n’est ni indifférente, ni impassible aux malheurs du monde, ni aux conflits qui l’entourent. Elle joue un rôle de médiation chaque fois qu’elle est sollicitée tout en prenant clairement position sur les responsabilités des uns et des autres. Elle l’a montré en condamnant l’intervention russe en Ukraine. L’OTAN doit veiller à informer régulièrement la Suisse de ses décisions en matière de sécurité collective.
La France dépend pour un quart de son gaz naturel de la Russie. Comment la France et l’Europe peuvent-elles réduire cette dépendance sans trop faire grimper l’inflation ?
L’inflation préexistait à la crise en Ukraine. Le cout de l’énergie s’était déjà renchéri avec la reprise vigoureuse de la croissance. La guerre en Ukraine et les sanctions à l’égard de la Russie ont encore amplifié cette tendance. La réduction rapide de nos approvisionnements en gaz venant de la Russie va nous conduire à diversifier nos sources, à amplifier les économies d’énergie, à accélérer la montée des renouvelables et à recourir à l’énergie nucléaire. Mais c’est vrai qu’il y aura des conséquences sur le pouvoir d’achat des Français. D’où l’enjeu de la réduction des inégalités et des revalorisations salariales.
Qu’est-ce qui doit figurer en tête de l’agenda de la nouvelle présidente ou du nouveau président ? Sur le plan social, mais aussi sur le plan économique ?
Au-delà des enjeux diplomatiques et militaires, le premier défi c’est de maintenir les effets d’une inflation dont nous n’avons plus le souvenir, et de réussir la transition énergétique. Le second, c’est de retrouver des finances publiques plus équilibrées après deux ans de « quoiqu’il en coûte » qui ont porté la dette publique à 115% du PIB. Enfin, c’est de donner priorités aux réformes de l’Education, de l’université et de la Recherche, dans un double souci de performance économique et de cohésion sociale.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.